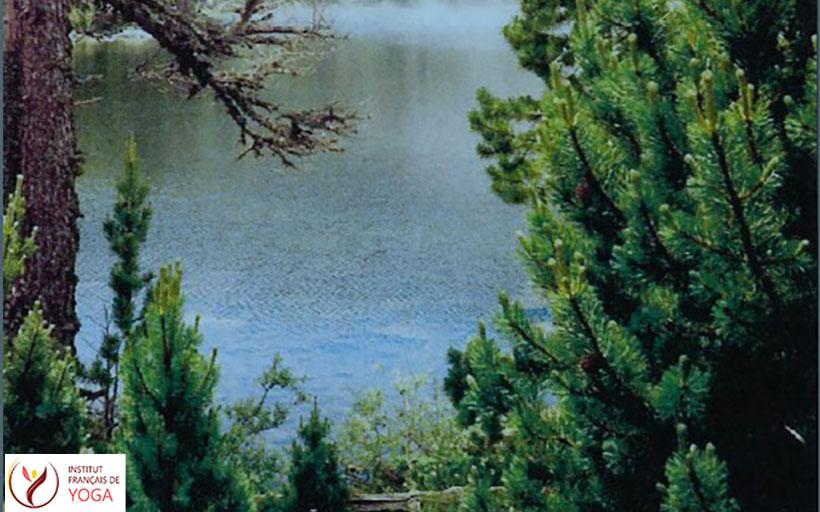Cet article est extrait de la revue « Aperçus » éditée par l’association régionale IFY Yoga Tradition Évolution et reproduit avec l’aimable autorisation de celle-ci.
« Question
Qu’est-ce qui est pour l’un et pour tous, oriental et universel, millénaire et actuel, et utilisable en toutes circonstances ?
« Bon d’accord, vous prêchez pour votre paroisse, mais à quoi ça sert votre yoga ? J’aurais quoi dans mon panier quand j’aurais fait mes courses ? »
Au début, un bout de bien-être et une brise de concentration. Si vous revenez régulièrement au magasin, une cascade de prises de conscience, parfois à la sauce piquante et parfois saupoudrées de sucre vanillé. Enfin vous pourrez prétendre à une meilleure compréhension du consommateur c’est-à-dire de vous-même, mais vous réaliserez également que toutes vos envies ou soi-disant besoins ne trouveront pas de produits immédiatement consommables. Il y faut de la patience et aussi participer activement à la gestion de la boutique. Toutefois, l’important est que vous aurez contribué par votre consommation, c’est-à-dire par votre pratique du yoga, à vivre votre vie les yeux plus ouverts, à agir envers votre corps avec plus de respect, à accorder au cœur plus de place dans vos choix et à montrer plus de considération aux autres et à l’environnement. «Il suffit d’y aller, c’est cela ?»
Décider
Mon père, Harry, a décidé de s’engager dans l’armée de l’air avant que la guerre ne soit déclarée en 1939. Son père, quant à lui, avait attendu la conscription d’office de la Grande Guerre et s’était retrouvé sur le front. Chair à canon. Revenu blessé, il a eu le malheur d’être remis de celle-ci avant la fin et a ainsi connu d’autres tranchées. Et une nouvelle blessure. Heureuse chance sans doute, car il n’a pas rejoint la statistique d’âmes tombées. Il est revenu, a rencontré ma grand-mère et fondé une famille. Né en 1920, Harry avait 19 ans quand il a annoncé la nouvelle à sa mère. Elle ne comprit pas et posa la question, «Pourquoi as-tu fait ça ?» Son fils lui expliqua qu’il ne voulait pas être dans l’armée de terre, ayant entendu les récits paternels, et le choix était encore ouvert aux volontaires : comme il ne nageait pas bien, il ne restait que les avions. Les décisions, nous en prenons tout le temps. Certaines ont plus d’impact que d’autres sur le déroulement de notre vie. Mais elles sont toutes agissantes et elles sont toutes motivées : nous pouvons en trouver les raisons. Certaines sont conscientes et d’autres non. Quand quelqu’un décide de commencer le yoga, il en est de même. Par exemple, lorsque la personne qui partageait ma vie m’a dit « Je vais faire du yoga », j’ai décidé de l’accompagner. Consciemment ma raison d’aborder le yoga c’était cela : je voulais rester à ses côtés. D’autres raisons plus profondes, inconscientes, étaient-elles à l’œuvre? Je crois que oui, considérant que, depuis plus de trente ans, j’y ai consacré une grande partie de mon temps. Quelqu’un peut décider de pratiquer le yoga pour être plus souple, pour apprendre à respirer, pour être moins distrait au quotidien, pour mieux se connaître etc. Quelqu’un d’autre peut décider d’essayer le yoga «pour voir» parce qu’une amie en a parlé de façon élogieuse, ou un médecin a suggéré que le problème «nerveux» pour lequel il était consulté pourrait avoir une origine psychosomatique, ou encore qu’un article dans un magazine montrait de bien belles images …
Quelqu’un aussi peut décider de ne pas faire du yoga parce qu’il pense que ce n’est qu’une gymnastique douce pour les femmes, ou parce qu’un livre tombé entre ses mains paraît très compliqué et mystique, ou encore parce que le prêtre de la paroisse s’est prononcé contre. Commencer ou non la pratique du yoga reste une décision personnelle, qui peut certes être influencée, mais qui revient néanmoins à chacun.
Découvrir
Je pense que les raisons pour lesquelles quelqu’un commence le yoga sont secondaires. Ce qui compte ce sont les découvertes qui vont nous faire persévérer. En effet, le yoga ne révèle ses secrets qu’à la personne qui poursuit ses efforts longtemps, sans interruption, avec confiance et enthousiasme. Pour être de cette catégorie de pratiquants, ou bien il faut être têtu comme une mule ou bien il faut avoir reçu quelques encouragements.
De quels genres ? Bien sûr, cela dépendra des raisons de chacun, conscientes ou inconscientes. Mais découvrir, par exemple, que l’on sort de la séance de yoga très détendu, alors que c’était apparemment pour des raisons esthétiques que l’on avait commencé peut encourager à poursuivre même sans «récompense» d’embellissement physique ou satisfaction plastique. Si cette détente nous éveille à une partie de nousmêmes que l’on ne connaissait pas ou nous parle d’un bien-être auquel on n’aspirait pas forcément, mais qui «touche» quelque chose de profond, on continuera. Et c’est ça l’essentiel. Patañjali, dans son traité fondamental, nous donne une belle liste de huit aspects qui constituent son yoga «intégral», comparable au pain complet, où rien n’aurait été enlevé au moment de passer les grains de blé aux meules pour faire de la farine. C’est sa «méthode», ce qu’il faudrait faire pour cheminer dans l’optique du yoga. Il s’agit :
- d’examiner et d’essayer de modifier son comportement avec les autres et envers son environnement,
- de soigner son style de vie et d’instaurer une discipline personnelle au quotidien,
- de travailler sur le fonctionnement équilibré du corps,
- d’utiliser les ressources qu’offre la respiration consciente,
- de mettre les sens au service de nos objectifs,
- de s’exercer dans l’installation et le maintien de l’attention,
- de favoriser l’état méditatif, dans l’action comme dans le recueillement,
- de s’ouvrir à ce qui peut donner unité et présence.
Toutefois, rares sont ceux qui décident de commencer avec tous les huit. D’ailleurs saisir ce yoga octogonal d’un coup d’œil serait comme regarder une grille de mots croisés en voyant immédiatement tous les mots – pas simple ! Également certains de ces huit aspects nous interpellent d’emblée, alors que d’autres nous paraissent beaucoup moins importants. Et plus tard ces impressions changent. Il faut du temps, le temps des découvertes. Des choses inattendues, par rapport à notre corps, notre souffle, nos pensées. Le temps de goûter aux techniques, de les apprivoiser.
Tout n’est pas tracé d’avance, mais, dans la palette des découvertes susceptibles de nous encourager à poursuivre, il existe un élément important, voire parfois déterminant. C’est la relation qui s’établit avec l’enseignant. Si cette relation nous inspire, si elle nous donne confiance et espoir, nous trouverons facilement l’énergie nécessaire pour persévérer et nous enregistrerons aisément ce qui est bon pour nous.
Idéalement l’enseignant proposera à l’élève des techniques adaptées et prononcera des mots qui l’encourageront et le stimuleront dans son entreprise. 11 aura besoin bien sûr d’écouter les propos de ce dernier, mais aussi d’être attentif à son comportement physique et psychique et, d’une manière générale, être à l’affût de tout signe susceptible de lui fournir des informations utiles que l’élève ne formulera pas forcément en paroles. Autrement dit, il est de la responsabilité du professeur de yoga d’observer son élève pour orienter le travail, et la simple question technique, c’est-à-dire la connaissance des exercices ou principes pédagogiques, n’est qu’une partie de l’affaire. Par exemple, un élève peut parler de problèmes de santé ou de difficultés relationnelles qui feraient orienter en premier lieu l’enseignant vers une pratique demandant implication et exigence de la part de l’élève. Mais il se peut qu’après une observation plus approfondie l’enseignant se rende compte que la personne est exagérément perfectionniste et que ses exigences envers elle-même sont éventuellement à l’origine de ses problèmes de santé ou de ses difficultés relationnelles. Ainsi l’enseignant pourrait intégrer dans la pratique proposée une dose d’exigence pour satisfaire ce besoin, mais également des éléments de pratique qui vont l’emmener vers plus de lâcher prise. Mais, de grâce, n’attendons pas de notre pauvre professeur de yoga d’être Superwoman ou Superman ! L’enseignant est un être humain avec les mêmes difficultés que n’importe qui. Son boulot est de poursuivre sa propre recherche et pratique pour être au mieux de ses possibilités quand il est en situation d’enseigner. La perfection n’existe pas. Imaginons donc que l’on ait trouvé des raisons suffisantes pour prendre la décision de commencer le yoga et que l’on ait poursuivi, stimulé par quelques découvertes liées à la pratique elle-même ou à la relation avec l’enseignant, que se passe-t-il alors ?
S’engager
Obtenir des bienfaits de la pratique de yoga devrait être au début une simple question d’exécution. « Faites telle ou telle posture. Respirez profondément. Concentrez votre attention sur ceci. » Si l’on joue le jeu, si l’enseignant ne fait pas que reproduire des schémas tout faits, et si l’on n’est pas allergique à un travail qui touche au corps, quelques fruits devraient tomber dans notre panier, ceux précisément dont je parlais plus haut : un bout de bien-être et une brise de concentration. On peut s’en réjouir. Parfois, cela peut suffire. Le yoga ne s’attend pas à ce que chacun veuille approfondir. Mais si la curiosité est éveillée, et qu’il semble probable qu’il y ait davantage à tirer de cette pratique que ce qui saute aux yeux, il nous est demandé de nous engage. Non pas comme mon père à la veille de la guerre. Il s’agit ici de passer de la conduite accompagnée à l’orientation personnelle du véhicule.
Être engagé dans le yoga, c’est se , prendre en charge. Quel dommage, soupirera-t-il ! J’étais si bien quand le professeur s’occupait de tout. J’avais un problème, l’enseignant trouvait une solution. J’étais tendu, sa séance me rendait calme et délié. Oui, c’est désolant, mais aller au-delà des ) – premières découvertes nécessite une prise en charge personnelle. J’aurai besoin d’introduire dans le quotidien une dose de discipline, une rasade de réflexion, et de l’ouverture en plus. S’agissant par exemple de la pratique des postures et des respirations conscientes, j’aurai à prendre la place de l’enseignant en ce qui concerne l’orientation. Je m’observerai, je réfléchirai, puis déciderai « Tu vas faire quelques enchaînements un peu toniques pour te réveiller, sinon tu vas dormir dans la position assise dans laquelle tu veux passer dix minutes à méditer sur un problème que tu as au travail. Si ‘ça ne réussit pas à te faire entrevoir une solution, ce n’est pas grave. Tu essaieras autre chose plus tard». S’engager, se prendre en charge, n’interdit pas la possibilité d’être aidé. C’est même conseillé, car on n’a pas toujours une vision suffisamment large et claire quand on est seul à prendre les orientations. Les choses qui nous conviennent ne sont pas forcément celles qu’il nous faut accentuer pour évoluer. La personne avec des articulations hyperlaxes va peut-être choisir toujours des postures qui vont dans le sens de l’assouplissement. La personne très volontaire va peut-être négliger l’abandon. Un doux rêveur va peut-être fuir dans de longues méditations.
Se prendre en charge ne peut être à l’ordre du jour que si nous avons déjà fait quelques récoltes, et ne peut être profitable que si nous nous faisons aider par un paysan qui connaît bien la terre et les saisons. Mais à un moment donné il est nécessaire de regarder notre petit lopin de terre, sachant quels légumes plaisent à notre palais et ont des chances de pousser, puis d’aller dans le cabanon, de sortir les outils et de se dire «Allez, tu es jardinier; alors au travail !». S’engager ainsi dans le yoga est la façon de «pratiquer» vraiment.
Et cela signifie quoi : pratiquer ?
Pratiquer
Un maître mot qui résume le cœur du yoga. Le cœur est le moteur. Le centre. Il s’agit de tout effort consciemment mis en œuvre pour avancer d’une situation vers une autre. D’un état vers un autre. Sans perdre l’acquis. Je Je suis à Narbonne et je veux aller à Paris. C’est déjà une situation heureuse. Je pourrais désirer me rendre à la capitale, mais ne pas savoir où je me trouve, ou encore arriver à me situer mais ne pas savoir où je veux aller. Il s’agit donc d’avoir goûté aux découvertes dont j’ai parlé plus haut. De pouvoir se déclarer jardinier. Le centre du yoga, le lieu d’engagement, est atteint quand on a déjà une très bonne idée d’où l’on se trouve et où l’on veut aller. On peut dire qu’on est prêt tout simplement à être un pratiquant. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’on n’a fait que se tourner les pouces avant ! L’effort n’est pas la propriété du pratiquant engagé. Mais antérieurement un défrichement a eu lieu, capable de rendre la terre accueillante pour les semences que l’on répand ensuite avec attention et savoir-faire. Alors, je suis à Narbonne et je veux aller à Paris. La pratique consiste à réfléchir sur le moyen de transport le plus approprié. Faire des bagages. Ou ne pas en faire. Prendre des renseignements sur l’état de la route si l’on choisit la voiture. Vérifier l’huile du moteur, faire le plein d’essence. Partir à une heure propice. Observer les panneaux d’indications. Faire demi-tour si l’on se rend compte d’une erreur d’orientation. Prendre des moments de repos. Et ainsi de suite …
Pratiquer c’est avancer dans la lucidité. Il peut s’agir de reconnaître un problème lié à l’enfance qui nécessite beaucoup d’efforts pour comprendre et pardonner ; de mettre en place une certaine discipline par rapport à son alimentation pour pallier une insuffisance ou un excès ; de lire des ouvrages capables de donner une v1s1on nouvelle ou renouvelée, une philosophie de vie empreinte d’un esprit de contentement ; d’entretenir la santé par de l’exercice physique, la régulation du souffle et de la relaxation ; de créer de l’espace par rapport à son corps et ses pensées grâce à l’entretien d’une propreté extérieure et intérieure – un espace apte à donner un esprit centré et heureux ; de cultiver confiance et humilité.
Pratiquer est un acte volontaire qui demande zèle et détermination pour fixer et obtenir un objectif ainsi qu’une résolution solide pour nous aider à tenir le choc face aux difficultés. Mais il peut devenir pénible et destructeur s’il est exercé dans l’isolement de la certitude qu’entoure l’égocentrisme volontariste qui dit« Je veux, et j’aurai ». Il faut bien une copine à la pratique.
Lâcher
Pratiquer est assurément bancal si je ne l’associe pas au lâcher prise. Avancer c’est bien beau, mais vais-je avoir la capacité d’abandonner des choses en route ou les traînerai-je comme des boulets ? Vais-je résister à des tentations susceptibles de me détourner de mon but ? Est-ce que je suis libre d’avancer et sinon qu’est ce qui m’enchaîne ?
Lâcher commence par une écoute de son état intérieur lorsque l’on est en chemin. Dans l’éventualité d’une panne sur la route de Paris, comment la vivraisje? Énervement ? Larmes ? Je rentre ? J’attends ? Le yoga considère que si l’on est prêt pour le voyage, prendre la route est autant affaire de rapport avec ses désirs et ses attentes qu’une capacité à appuyer sur l’accélérateur et tourner le volant.
Lâcher c’est aussi s’alléger. Partir d’une situation vers une autre implique de laisser quelque chose. Je ne peux pas prendre tous mes meubles dans la voiture avec moi lorsque je me rends à Paris. Je ne peux pas changer et rester la même personne. Sur les pistes du yoga, je rencontrerai mes « démons » ; j’aurai à les reconnaître et les accepter. La capacité à lâcher est mon amie pour cela. J’aurai à affronter des obstacles : connaître la souffrance, des états malaisés.
La pratique seule ne fera pas le poids. J’aurai à mesurer la haute mainmise de mes habitudes sur mon comportement à les mettre en lumière et en rire. Je ne peux pas construire du neuf si je n’abandonne pas mon attachement à l’ancien.
Face aux multiples aléas qui sont liés au simple fait de vouloir vivre autrement que téléguidé par les démons, les obstacles et les habitudes, l’arme absolue est le lâcher prise. Le lâcher s’accompagne de sourires et non grimaces. Il caresse la volonté brute avec des clins d’œil complices et tendres : « Ne t’en fais pas » ; « Ce n’est pas grave ». Ses ennemis sont la simulation, la tranquillité plaquée, la résignation maquillée en acceptation. On le nomme aussi sagesse. Une approche de la vie, empreinte de philosophie, dont les grandes lignes relèvent de l’expérience plus que de l’étude. Une capacité sans cesse accrue à mettre en perspective les événements qui viennent écrire le livre de notre vie. Le flair pour déceler des liens entre les faits et le sens qui a creusé les sillons pour que «cela arrive». Une lucidité propice à comprendre au-delà de !’immédiatement compréhensible. Puis, surtout, le lâcher prise – quelle sagesse – c’est ne pas se prendre la tête ! Il fait la part belle à la simplicité.
Intégrer
La pratique et le lâcher prise forment ensemble le cœur du yoga qui se met à battre au moment propice – quand les découvertes ont fait naître l’engagement. Et lorsque ce tandem de cœur rencontre les huit aspects qui font bouger la machine c’est le yoga de la méthode et sa carburation qui font un ménage. Un ménage dans le sens qu’ils s’unissent, trouvent intérêt à s’intégrer dans une même équipe, savent unir leurs forces pour cheminer vers un but mutuellement admis. Un ménage aussi dans le sens qu’ils nettoient. Ils rendent propre. Place nette.
L’ancien toujours renouvelé. Et si le yoga commençait quand on se mettait à faire le ménage consciemment en attendant l’invité inconnu ?
(texte extrait de : « Propos Simples sur le Yoga >> – Editions : Les Cahiers de Présence d’Esprit) »
Martyn NEAL, formateur IFY – 2005