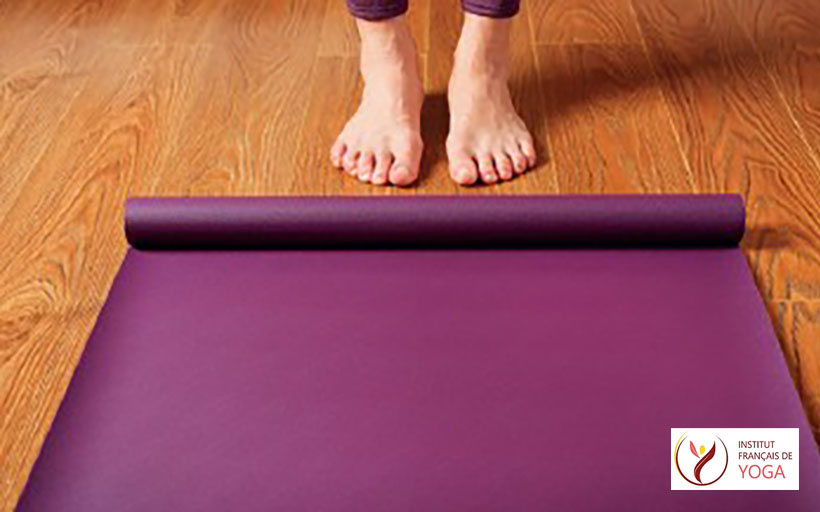Cet article est extrait de la revue « Aperçus » éditée par l’association régionale IFY Yoga Tradition Évolution et reproduit avec l’aimable autorisation de celle-ci.
« Nous avons étudié le début du chapitre un, onze aphorismes, lors des quatre derniers articles . Ce premier chapitre porte le nom de samādhi. Le mot yoga et le terme samādhi ont une signification très proche. En effet, si yoga désigne le fait de relier, comme le joug relie deux bœufs, samādhi signifie que deux choses sont devenues une, comme lorsqu’une rivière rejoint la mer.
La démarche du yoga présentée par Patañjali vise à produire cet état d’unité chez le pratiquant.
Cependant, à l’inverse de la conjonction de la rivière et de la mer, pour l’état de yoga, les choses qui deviennent unes demeurent intactes dans l’union. L’auteur de ce merveilleux traité pose dès le début le critère fondamental pour développer cet état : il convient d’étudier et de comprendre le fonctionnement du mental afin de l’accompagner et de le diriger en conscience.
Cela permet une plus grande transparence à notre dimension spirituelle et, par la même occasion, moins d’identifications et de projections.
Il dévoile de I, 12 à I, 29 ce que je nomme les deux états d’esprit pour la mise en œuvre des techniques et méthodes données au second chapitre.
Préalablement à l’étude du douzième aphorisme, jetons un coup d’oeil sur le 23. Voici la formule : īśvara pranidhānāt vā. L’emploi par Patañjali du terme “vā“, qui signifie “ou bien“, indique qu’il existe un choix. Il est admis que ce choix est entre la proposition du sūtra 12 et celle du 23. Précisément entre l’élan d’engagement associé au lâcher prise et l’abandon au Divin. Cette proposition me paraît fort “laïque“ ! Les personnes qui croient en Dieu (quelle que soit leur religion) peuvent cheminer dans le yoga, accompagnées de leur croyance. Et celles qui ne sont pas croyantes peuvent également cheminer dans le yoga, grâce au développement d’un esprit alliant l’engagement et le lâcher prise. Il n’est pas interdit d’ailleurs aux croyants, ni aux agnostiques, d’utiliser les deux ! Nous reviendrons ultérieurement sur cette notion de Dieu dans le yoga sūtra, mais pour l’heure étudions le sūtra I, 12 : abhyāsavairāgyābhyām tat nirodhaḥ.
Patañjali annonce que pour parvenir à diriger et maintenir dirigé (nirodha) cela (tat), c’est-à-dire le fonctionnement du mental, deux éléments sont nécessairement associés (bhyām) : abhyāsa et vairāgya. Ces deux termes sont habituellement traduits respectivement par pratique et détachement. Je vous soumets une autre manière de les interpréter.
Depuis de nombreuses années maintenant, je préfère la formule “élan d’engagement“ au terme de “pratique“ pour interpréter le mot sanscrit “abhyāsa“. En effet T.K.V. Desikachar m’a signalé que ce mot venait de deux racines : yāh qui désigne un mouvement vers l’avant, voire même une lancée, comme le javelot en athlétisme, et abhi qui indique une origine interne, intime.
Ceci pourrait être comparé à une sortie en voiture. Vous savez où vous voulez aller et vous maîtrisez la conduite d’un véhicule. Vous embrayez, engagez alors la vitesse, desserrez le frein à main et démarrez pour vous aventurer sur la route vers votre destination. Très différent de si, mal garée, votre voiture est embarquée et mise en fourrière… ! Dans les deux cas il s’agit d’un mouvement, mais dans ce deuxième déplacement de l’automobile il n’y a pas de lien avec une intention ou un objectif spécifique du propriétaire et, de plus, l’énergie qui initie le déplacement vient de l’extérieur.
Cela signifie que pour nous, pratiquants de yoga, l’élan d’engagement désigne bien une volonté de s’élancer vers un objectif. Et l’origine des deux – la volonté et le choix de l’objectif – se trouve dans nos propres réflexions, nos propres désirs, nos propres ardeurs, nos propres forces. Quelqu’un qui décide de frapper à la porte d’un cours de yoga possède une ou plusieurs motivations – par exemple : apprendre à respirer, soulager des douleurs au dos, être plus détendu, une aspiration à une vie plus saine, spirituelle ou autre… Si cette personne est poussée par des tiers – son conjoint ou conjointe, parents ou amis etc. qui lui disent « ça te fera du bien », elle ne reste pas longtemps en général. Un ami m’a soufflé « l’expérience de l’autre est comme un peigne pour chauve…! ». Alors qu’un engagement réfléchi et motivé donne un enthousiasme qui stimule, met en mouvement et souvent parvient à durer dans le temps.
Cependant, traduire abhyāsa par pratique n’est pas faux – tant de commentateurs emploient ce terme, y compris mon enseignant. Il n’en demeure pas moins que “pratique“ est le vocable que nous utilisons la plupart du temps pour désigner ce que nous faisons sur un tapis de yoga, et c’est là que la confusion peut facilement s’installer. Considérer que abhyāsa se limite à un temps donné sur le tapis est terriblement réducteur…
J’affectionne également le terme de “exercice“ pour éclairer abhyāsa, moins sujet aux malentendus que “pratique“. Nous pourrions dire, dans le sillage de Karlfried Graf Dürckheim, psychothérapeute et la réflexion sur son comportement envers le monde environnant, les techniques respiratoires, la concentration, la méditation, le ralliement des sens, le développement de la confiance et de l’humilité etc. Ainsi nous pourrions adhérer sans ambiguïté au “quotidien comme exercice“ de Dürckheim !
Alors, afin de rendre toutes les nuances que j’entrevois dans le sūtra en question, en voici une interprétation personnelle.
L’élan d’engagement sur la voie du yoga, avec ses objectifs et stratégies nécessaires, devrait être imprégné d’une démarche de conscience et de liberté au regard des excès qui peuvent être engendrés par le désir et la passion. Avec un tel état d’esprit, les techniques et aspects de la pratique du yoga amèneront sûrement au centrage et à l’apaisement du mental.
Je développe. Bien que l’idée d’engagement soit certes moins puissante que de prononcer des vœux, par exemple, il possède pourtant une force qui mobilise l’énergie. Une énergie qui puise dans le désir et la passion. Or, la passion peut parfois nous brûler les ailes… Convaincu qu’abhyāsa seul soit potentiellement dangereux, d’après moi, Patañjali propose que l’élan d’engagement puisse être accompagné du lâcher prise – vairāgya. Bien que ce terme soit l’opposé même de l’attachement passionnel (rāga), l’emploi du mot détachement évoque parfois un genre de froideur, d’attitude hautaine, voire un manque de sensibilité. Tandis que lâcher prise suggère quelque chose qui détend, qui apaise, qui rétablit un équilibre.
Réduire l’attachement passionnel est synonyme d’une croissance de la liberté. En effet, pour un être humain, rāga constitue bien un genre de prison dont la sortie est jalonnée par des prises de conscience successives qui viennent poser, reposer et rasséréner le séquestré. Vairāgya confère une tranquillité à l’engagé…
Cependant, suivant l’adage consacré : ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain ! Le désir et la passion sont indispensables pour avancer. Comment mettre en place une pratique régulière sur le tapis de yoga, sans le désir de se rééquilibrer quotidiennement, sans la passion pour des découvertes corporelles et respiratoires ? Comment bâtir une stratégie pour développer l’état méditatif dans sa vie, sans appétence ? Comment remettre en cause une situation de vie, sans une volonté de ne pas s’endormir sur ses lauriers ? Au demeurant, il s’agit bien de l’association, de l’alliance, d’un jumelage de ces deux aspects qui constitue cet état d’esprit particulier pour avancer sereinement sur le chemin du yoga.
Je soutiens que cette alliance de l’élan d’engagement et du lâcher prise n’est pas une méthode mais bien un état d’esprit. Tout d’abord, je suis persuadé que les systèmes présentés au second chapitre du yoga sūtra – le yoga de l’action au quotidien (kriyā yoga) et le yoga à huit aspects (aṣtānga yoga) – sont assez conséquents pour ne pas avoir besoin de moyens supplémentaires. En second lieu, il me semble que ces deux propositions au premier chapitre, nommément abhyāsavairāgya, l’élan d’engagement et lâcher prise (I, 12 à 16) et îśvara pranidhāna, l’abandon au Divin (I, 23 à 29), constituent deux états d’esprit distincts pour mettre en œuvre les techniques et méthodes proposées au deuxième chapitre.
Une question m’est souvent posée concernant la différence entre le lâcher prise et l’abandon au Divin. En effet, les deux notions sont proches lorsqu’on considère que la première implique une acceptation des évènements de la vie et des situations que nous sommes appelés à vivre, et que la seconde s’inscrit dans l’idée qu’il existe “plus grand que soi“ et que sa propre volonté, aussi puissante qu’elle puisse être, ne garantit pas le résultat souhaité. Bien que nous pourrions discuter longtemps sur des nuances dans ces interprétations, ce qui me paraît fondamental est le fait que Patañjali place l’abandon au Divin seul, alors que le lâcher prise doit obligatoirement être associé à l’élan d’engagement pour être productif.
La prochaine fois que vous vous installerez sur votre tapis et que vous commencerez une pratique du yoga, observez votre état d’esprit dans chacun des exercices. Voyez l’équilibre entre votre élan d’engagement et votre capacité à lâcher prise. Ajustez chaque fois que vous constatez une présence plus forte de l’un ou de l’autre. Toutefois, acceptez à l’avance que la parfaite symétrie entre les deux est quasi impossible !!!«
Martyn NEAL, formateur IFY – 2024